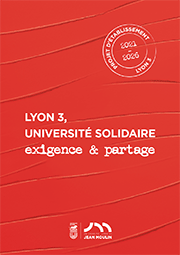AccueilRechercheProgrammes et productions scientifiquesThèsesThèses soutenuesThèses soutenues - 2025
-
Partager cette page
- Recherche,
- Philosophie,
PELUSO Lavinia
La démocratie dans les Lois de Platon : influences historiques et modèles théoriques
Thèse en Philosophie, soutenue le 14/02/2025.
La pensée politique occidentale, qui trouve ses fondements dans la réflexion platonicienne, a triomphé à l’ère moderne avec la victoire de la démocratie. Cependant, cette tradition a commencé par une critique de la démocratie elle-même, élaborée par le fondateur de la tradition occidentale. En effet, Platon attaque les fondements anthropologiques et les valeurs fondatrices de la démocratie, comme la liberté et l’égalité des citoyens. Cette condamnation est claire dans la République, mais dans les Lois la question n’est pas aussi immédiatement résolue. L’ambigu?té de Platon réside dans le fait que, tout en critiquant la démocratie athénienne, certains de ses éléments et de ses institutions sont utilisés dans les Lois, bien qu’avec un contenu différent. C’est à partir de la caractérisation de la démocratie comme régime du demos qui découle la critique platonicienne de cette forme politique. Platon conteste l’assomption démocratique de l’égalité des hommes en vertu des différentes capacités et connaissances qu’ils possèdent, mais il réfute aussi celle de la liberté puisque tous les hommes, sauf exceptions, sont influencés par l’irrationalité et ne peuvent pas en tant que tels représenter des acteurs politiques conscients. La connaissance constitue la seule justification légitime du pouvoir : du fait de la rupture du rapport entre kratos et connaissance, la démocratie mène en sens inverse de celui souhaité par Platon, en vertu de l’extrême liberté qui y règne. Pour ce qui concerne la structure de la thèse, nous proposons un examen des Lois en suivant la structure du texte avec une perspective attentive à la confrontation de Platon avec Athènes et la forme démocratique contemporaine. Après avoir encadré le dialogue d’un point de vue chronologique et structurel, le chapitre I vise à montrer comment la discussion des trois premiers livres constitue le fondement théorique du projet législative et constitutionnel auquel Platon se consacre à partir du livre IV, qui sera pris en considération dans les chapitres II et III. Nous traitons donc tout d’abord les catégories philosophiques des premiers livres du dialogue afin d’obtenir les outils conceptuels nécessaires pour interpréter le reste du texte. Au chapitre II, nous procédons à une comparaison entre la structure socio-économique d’Athènes et celle de Magnésie, la cité des Lois. La configuration géographique, la population et l’organisation territoriale, prises en compte dans les livres IV et V, représentent le fondement de la législation présentée à partir du livre VI. L’objectif de la thèse est de proposer une comparaison entre ce que Platon projette pour Magnésie et ce que l’on sait de la démocratie athénienne gr?ce aux témoignages des autres auteurs anciens, en s’intéressant également à l’histoire de la forme démocratique avant la naissance de Platon. Dans le contexte d’une telle comparaison entre Athènes et Magnésie, nous examinons les aspects de comparaison explicite entre les institutions administratives et gouvernementales des deux cités. L’examen analytique des différences entre la composition et les fonctions de chaque organisme de Magnésie et de son homologue athénien s’accompagne d’une emphase sur les fonctions publiques qui représentent des éléments de nouveauté propres au cadre platonicien. Au chapitre III, nous traitons de ce qui relève du domaine législatif et des dynamiques procédurales ordonnées pour Magnésie. Les sections du code des lois sont analysées telles qu’elles sont présentées par Platon. L’analyse des magistratures et des lois de Magnésie, menée conjointement avec celle de leurs homologues athéniens, révèle comment la lecture platonicienne de la démocratie athénienne dans les Lois se compose de deux aspects. D’une part, la récupération ambigu? des institutions démocratiques qui sont introduites pour encourager les citoyens à obéir. De l’autre, la polémique radicale constante, pas toujours explicite mais évidente dans les moments argumentatifs fondamentaux.
Mots-clés : Platon ; Politique ; Dialogue ; Lois ; Athènes ; Démocratie ; Constitution ; Peuple ; Liberté ; ?galité ; ?quité
Western political thought, which finds its foundations in Plato’s thought, triumphed in the modern era with the victory of democracy. However, this political tradition began as a critique of democracy itself by the founder of this same tradition. Indeed, Plato attacks both the anthropological foundations and the founding values of democracy, such as freedom and equality of citizens. This condemnation is clear in the Republic, but in the Laws the question is not as evident as it is in the former dialogue. Plato’s ambiguity depends on the fact that, while criticizing the Athenian democracy, some of its elements and institutions are used in the Laws, although with different content. Plato’s critique of democracy logically derives from the characterization of democracy as regime of the demos. Plato contests the democratic assumption of human equality by virtue of the different capacities and knowledge that humans possess, but he also refutes the assumption of freedom since all men, with very few exceptions, are influenced by irrationality and cannot represent conscious political actors as such. Knowledge constitutes the only legitimate justification of power; due to the breakdown of the relationship between kratos and knowledge, democracy leads to the opposite direction to that desired by Plato, by virtue of the extreme freedom that reigns there. As for what concerns the structure of the thesis, we propose an examination of the Laws following the structure of the text, with a perspective attentive to the confrontation of Plato with Athens and the contemporary democratic regime. After having framed the dialogue from a chronological and structural point of view, Chapter I aims to investigate how the discussion of the first three books of the Laws constitutes the theoretical foundation of the legislative and constitutional project that Plato elaborates from Book IV, which will be taken into account in Chapters II and III. Therefore, we first consider the philosophical categories traced in the first books of the dialogue in order to obtain the conceptual tools necessary to analyze the rest of the text. In Chapter II, we outline a comparison between the socio-economic structure of Athens and that of Magnesia, the city of the Laws. The geographical configuration, the population and the territorial organization of the city, which are taken into account in Books IV and V, represent the necessary basis for the legislation outlined from Book VI onwards. The aim of the thesis is to propose a comparison between what Plato projects for Magnesia and what we know about Athenian democracy thanks to the testimonies of other ancient authors, also focusing on the history of the democratic form before the birth of Plato. In the context of such comparison between Athens and Magnesia, we examine aspects of explicit comparison between the administrative and governmental institutions of the two cities. The analytical examination of the differences between the composition and functions of each organism of Magnesia and its Athenian counterpart is accompanied by the emphasis on those public functions which represent an innovation and are peculiar to the Platonic framework. In Chapter III, we deal with what falls within the legislative domain and procedural dynamics that Plato elaborates for Magnesia. The sections of the legislative code designed for the city of the Laws are analyzed as presented by Plato. The analysis of both the magistratures and the laws of Magnesia, carried out jointly with those of their Athenian counterparts, reveals how the Platonic reading of Athenian democracy in the Laws is composed of two aspects. On the one hand, the ambiguous recovery of democratic institutions that Plato introduces so as to encourage citizens to obey. On the other, the constant radical polemic, which is not always explicit, but it is evident in fundamental argumentative moments of the dialogue.
Keywords: Plato; Politics; Dialogue; Laws; Athens; Democracy; Constitution; People; Freedom; Equality; Equity
Direction de thèse : M. PRADEAU Jean Fran?ois et M. CENTORE Bruno
Membres du jury :
- M. Jean-Fran?ois PRADEAU, Professeur des universités, Université Jean Moulin Lyon 3, France, Directeur de thèse
- M. Bruno CENTRONE, Professeur ordinaire, Université de Pise, Italie, Directeur de thèse
- M. Federico Maria PETRUCCI, Professeur ordinaire, Université de Turin, Italie, Rapporteur
- M. Francesco FRONTEROTTA, Professeur associé, Université Rome La Sapienza, Italie, Rapporteur
- Mme Maria Michela SASSI, Professeure ordinaire, Université de Pise, Italie, Examinatrice
- M. ?tienne HELMER, Professeur associé, Université de Porto Rico, Etats Unis, Examinateur
Présidence du jury : Mme SASSI Maria Michela